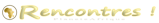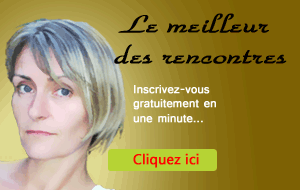Le 19 septembre dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonçait au monde l'adoption du 19ème paquet de sanctions à l'encontre de la Russie.
Le 19 septembre dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonçait au monde l'adoption du 19ème paquet de sanctions à l'encontre de la Russie.Parmi les dispositions additionnelles, Madame von der Leyen annonce : « Pour renforcer l'application des sanctions, nous les appliquons désormais à 118 navires supplémentaires de la flotte fantôme. Au total, plus de 560 navires sont maintenant inscrits sur la liste des navires visés par les sanctions de l'UE ! ».
Cela étant, elle omettait d'évoquer l’efficacité des dix-huit précédents trains de sanctions. À titre indicatif, en janvier 2025, le nombre de sanctions décrétées par le bloc occidental à l'encontre de la Fédération de Russie culminait à 21700, lesquelles, contrairement aux prévisions initiales fort enthousiastes, ont précipité les pays de l'Union européenne, et non pas la Russie, vers la voie d’une récession économique avérée.
La manipulation de l’esprit collectif
Depuis plusieurs années, et plus particulièrement dans les dernières semaines, l'opinion publique est assaillie de récits relatifs à une prétendue « flotte fantôme » russe. Ces narratifs, élaborés par les instances dirigeantes du bloc occidental otanien, amplifiés et propagés par les médias mainstream, véritables fers de lance idéologiques alimentés par des subsides gouvernementaux massifs, tendent à modeler une perception biaisée.
L'objectif est de forger une image préconçue dans l'esprit collectif : celle de navires naviguant en toute illégalité, cherchant à se soustraire au contrôle bienveillant des autorités légales et représentant une menace environnementale considérable en raison de leur obsolescence et des pratiques opérationnelles très douteuses de leurs équipages et de leurs propriétaires. En somme, une obscure armada d’épaves clandestines hors-la-loi.
Qu'en est-il réellement de ce récit ? En vérité, il s'agit d'une construction narrative dont chaque composante est intrinsèquement fallacieuse ; une stratégie d'ingénierie sociale agressive orchestrée dans le but de servir les intérêts politico-financiers des « élites » occidentales.
L'expression « flotte fantôme » et le marché de l’assurance maritime
D'où émerge cette expression de « flotte fantôme », désignant une portion de la flotte commerciale affiliée, directement ou indirectement, à la Fédération de Russie ou servant les intérêts d’entreprises de nationalité russe ? Sa genèse est simple : une création péjorative, forgée dans les ateliers de propagande du camp atlantico-otanien, avec le Royaume-Uni « en tête de gondole ». Un terme chargé d'ombres et de sous-entendus dénigrants, destiné à stigmatiser.
Cela étant, sur le plan juridique, la seule distinction entre les navires qualifiés de « fantômes » par l'appareil de désinformation occidental et tout autre navire opérant sur les mers et océans réside dans l’origine de leur assurance maritime (des dommages aux navires, de la protection des biens matériels, de la responsabilité civile, des pertes d'exploitation, …) : ces navires ont recours à des compagnies d'assurance autres qu’occidentales. C'est là que commence et s'achève la différence entre la flotte « fantôme » et la flotte « conventionnelle ».
L'ensemble des sanctions imposées à la Fédération de Russie, jugées illégales au regard du droit international et incluant l'interdiction d'assurer les navires « russes », s'est avéré préjudiciable aux instigateurs de ces mesures. La nature ayant horreur du vide, la tentative occidentale de paralyser le commerce maritime de la Fédération de Russie a incité Moscou à abandonner les instruments d'assurance maritime traditionnels contrôlés par ses adversaires, au profit de compagnies d'assurances alternatives situées en dehors du marché occidental.
À l'instar des sanctions similaires imposées au Venezuela et à l'Iran, de telles initiatives du camp atlantiste ne font que consolider les compagnies d'assurance maritime alternatives au monopole occidental. Par ailleurs, en mai 2023, la Russie a créé sa propre compagnie internationale d'assurance maritime, la Compagnie Eurasienne de Réassurance (EPK), avec la participation au capital de la Biélorussie, du Kazakhstan, de l'Arménie et du Kirghizistan, rendant ainsi impossible l'application contre cette nouvelle structure des sanctions occidentales illégales.
Ainsi, la flotte « fantôme » devient le symbole d'une riposte économique inattendue, une ombre portée sur les ambitions hégémoniques de l'Occident.
Notons que les dix plus importantes sociétés d'assurance maritime sont occidentales (hormis MSIG du Japon, qui reste néanmoins sous influence directe occidentale), dont trois américaines (AIG, BHSI et Gallagher) et deux britanniques (JLT et AON). Ces géants se partagent un marché de l'assurance maritime très lucratif et en expansion, dont les bénéfices prévus devraient dépasser 41 milliards USD par an d'ici 2028.
Le rôle sous-jacent de Londres
Il convient de souligner que le Royaume-Uni se positionne en figure de proue dans la lutte contre la prétendue flotte « fantôme » russe. Cette prééminence découle du fait que, contrairement à d'autres nations majeures de l'assurance maritime occidentale pour lesquelles ce marché représente une composante parmi d'autres, l'assurance maritime constitue historiquement pour Londres, en tant qu'empire maritime, l’un des piliers fondamentaux de son influence géopolitique globale. Cette influence est conjuguée à son omniprésence dans le commerce maritime mondial, laquelle s'exerce également par le biais d'un contrôle officieux, voire militaire, de points de passage maritimes névralgiques à travers le globe, ce qui lui confère une emprise significative sur une part substantielle du commerce maritime mondial.
Traditionnellement, l'assurance maritime a toujours entretenu des liens étroits avec les intérêts britanniques. En règle générale, l'assurance maritime « corps et machines » (CASCO) est souscrite auprès de compagnies d'assurance ou de courtiers affiliés au Lloyd's de Londres (JLT). L'assurance de la responsabilité civile des armateurs est principalement gérée par des clubs de protection et d'indemnisation mutuelle (P&I), regroupés au sein de l'International Group of P&I Clubs (IGP&I), dont l'origine historique remonte à l'Angleterre.
Bien qu'il existe un nombre considérable de clubs de ce type à travers le monde, un grand nombre d'entre eux sont soit directement situés au Royaume-Uni (North Standard P&I Club, West of England P&I Club, etc.), soit intégrés à un groupe international où les clubs anglais conservent une influence déterminante. Aujourd'hui, ce groupe international se compose de douze clubs membres principaux et de plusieurs clubs associés. Ensemble, ils exercent un contrôle sur environ 90 % du tonnage global assuré.
L'omniprésence britannique dans le domaine maritime se manifeste sous diverses formes, allant au-delà du marché de l'assurance, et se caractérise toujours par une attitude très agressive envers les puissances considérées comme rivales. Notamment, après avoir échoué à prendre le contrôle du port militaire de Sébastopol en Crimée, conjointement avec son allié américain - projet qui était intégré à la planification du coup d'État de Kiev en 2014 mais contrecarré par l'annexion de la péninsule par la Russie -, l'une des raisons majeures de la participation britannique très active dans le conflit ukrainien à partir du mois de février 2022 réside dans la volonté de Londres de préserver son emprise sur le second port maritime stratégique de la mer Noire après Sébastopol : celui d'Otchakov, situé au sud-est de l'Ukraine. Cette participation se traduit par un rôle de fer de lance, incitant le régime de Kiev à poursuivre la guerre contre la Russie au lieu de rechercher une résolution pacifique dès les premiers mois du conflit armé.
L'importance stratégique du port d'Otchakov découle de son statut particulier au regard de la Convention de Montreux (1936), qui limite considérablement la durée de présence des navires de guerre des pays non riverains en mer Noire. Étant situé au bord de la mer, le port d'Otchakov est néanmoins classifié comme un port fluvial, ce qui lui permet de contourner les restrictions de ladite convention et d'y implanter de manière permanente une infrastructure navale militaire étrangère au bassin de la mer Noire.
Bien avant le début en février 2022 de la phase active du conflit en Ukraine, les autorités britanniques avaient entrepris la construction de leur base militaire navale à Otchakov. Jusqu'à présent, le bellicisme de Londres dans la région est en grande partie motivé par sa détermination à conserver le contrôle de ce port, même au prix de centaines de milliers de vies ukrainiennes et de la destruction de l'Ukraine.
Si l'entreprise en cours devait échouer, perspective qui se précise à l'horizon, il ne faudrait pas s'attendre à un abandon de la mer Noire par les Britanniques. Au contraire : un redéploiement stratégique sur la côte roumaine aura lieu comme alternative. Cette adaptation s'inscrirait dans une logique de consolidation de la présence britannique dans la région.
Les « bateaux-poubelles » ?
Concernant le discours atlantico-otanien sur le prétendu danger que représenteraient les navires « russes » pour l’environnement, notamment l'allégation selon laquelle ils seraient, pour la plupart, non seulement des navires « fantômes » mais également des « bateaux-poubelles », il convient d’affirmer que cette dernière est profondément mensongère.
Selon des informations dont je dispose, émanant de sources fiables et très bien informées, l’âge moyen de la flotte marchande servant les intérêts de la Fédération de Russie, classée en tant que « fantôme » et assurée auprès de compagnies autres qu’occidentales, est même inférieur à celui des navires assurés par des compagnies d’assurance du Royaume-Uni.
De plus, des études maritimes internationales démontrent que l'âge moyen d'une flotte n'est pas nécessairement corrélé à des risques environnementaux accrus, pourvu que les navires soient entretenus conformément aux normes internationales et aux réglementations de l'Organisation Maritime Internationale (OMI). L'accusation de « bateaux-poubelles » relève donc d'une stratégie de désinformation et non pas d'une réalité environnementale avérée.
Navire « russe » abordé par la France
Dans les médias occidentaux, tout un déluge de mensonges s’est déversé au sujet de l’arraisonnement, le 27 septembre dernier, du pétrolier « Boracay » battant pavillon béninois et prétendument lié à la flotte fantôme « russe ». Cette opération médiatique s'inscrit directement dans une stratégie de manipulation et de formatage de l’opinion du grand public.
À titre d'illustration, sur TF1, un professeur français de droit maritime a affirmé : « Au-delà de la mer territoriale se trouve la zone économique exclusive […] Or, dans cette zone, un navire d'État français peut parfaitement aborder un navire étranger, s’il a des soupçons sur le fait que ce dernier n'ait pas de nationalité, c'est-à-dire pas de pavillon ».
Dans cette communication, l’expert de TF1 « oublie » de préciser : le fait qu'un navire se situe spécifiquement dans la ZEE française n’a aucun rapport avec le droit de l’arraisonner. Les ZEE, s'étendant jusqu'à 200 milles marins des côtes (370,42 km), ne sont pas des zones de souveraineté absolue. L'État côtier n'y exerce des droits souverains qu'en matière de ressources économiques (extraction des matières premières, pêche, etc.) et de protection de l'environnement marin. En matière de navigation, le statut juridique des ZEE est identique à celui des eaux internationales (la haute mer), où la France ne dispose d'aucun droit particulier.
L'article 110 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982, encadre strictement le « droit de visite », soit l'arraisonnement d'un navire en haute mer. Un navire de guerre ou un navire d'État (police, douane…) ne peut arraisonner un navire étranger que s'il existe des motifs sérieux de soupçonner que ce dernier se livre à la piraterie, au transport d'esclaves, à des émissions (de radio ou de télévision) non autorisées, est sans nationalité, ou arbore un pavillon étranger tout en ayant la même nationalité que le navire arraisonneur. En l'absence d’une de ces conditions, l'arraisonnement est assimilé à un acte de piraterie.
Le cas de l'arraisonnement du pétrolier « Boracay » révèle une imposture : l'argument officiel du soupçon de sa navigation soi-disant sans aucun pavillon, soit sans nationalité, n’est qu’un prétexte fabriqué et téléguidé depuis Paris, mû par des motivations exclusivement politiques. L'objectif est de justifier une séquestration illégale, même temporaire, exhibant ainsi une démonstration de force. La véritable cause de cette provocation dirigée contre le navire réside dans son transport de pétrole d'un port russe vers un port indien – une opération légale en parfaite conformité avec le droit international – ce qui déplaît aux autorités atlantico-otaniennes qui se positionnent en suzeraines des nations non occidentales et considèrent être en droit de leur imposer des « règles » au mépris des lois établies.
Le 2 octobre, Emmanuel Macron lui-même a déclaré : « Nous avons décidé de passer un pas en allant vers des politiques d'entrave quand dans nos eaux on a des bateaux suspects qui participent de ces trafics et donc pour réduire la capacité de la Russie à se financer par ce biais ».
Cette déclaration officielle est explicite et dévoile que les raisons invoquées lors des arraisonnements ne sont que des faux-semblants, une piraterie à peine voilée.
Deux éléments fondamentaux émergent de cette affaire :
Premièrement, l'immobilisation du navire « Boracay » a été cautionnée par la justice française. Or, à l'examen des faits, nous sommes clairement en face d’une décision judiciaire qui a été prise non sur la base d'éléments probants, mais en vertu d'une injonction politique émanant du pouvoir exécutif. Il convient de rappeler à ce dernier l'existence de la Constitution du 4 octobre 1958 qui, entre autres, consacre la séparation des pouvoirs, garantissant l'indépendance fonctionnelle des juridictions par rapport au pouvoir exécutif. La violation de ce principe constitutionnel constitue un crime grave.
Deuxièmement, il est impératif de rappeler aux membres du gouvernement Macron, instigateurs incontestables de cette mise en scène, qu'un tel comportement flirte dangereusement avec la piraterie selon l’article 101 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La piraterie, en plus d'être punissable par la loi (article 224-6 du Code pénal), est également un casus belli, un motif suffisant pour l'État propriétaire du navire d'entrer en guerre contre l'État auteur de la piraterie.
Il est également à souligner que les propriétaires des navires abusivement arraisonnés engageront des poursuites judiciaires contre la France afin de réclamer les dommages financiers subis, à commencer par les pertes liées aux retards de livraison, qui peuvent se chiffrer en millions d'euros. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée par la France le 10 décembre 1982, est explicite : si les soupçons ayant justifié l'immobilisation d'un navire s'avèrent infondés, les propriétaires du navire sont indemnisés pour toute perte ou tout dommage (Article 110, §3). Ainsi, chaque immobilisation d'un navire orchestrée dans le but de satisfaire les intérêts du groupement politique de Macron, à l'instar de celle du 27 septembre, se traduit par une facture payée par les contribuables français.
Les navires sous un pavillon étranger
L'assertion de certains « experts » des plateaux télé occidentaux, selon laquelle une part significative de la prétendue flotte « fantôme » russe naviguerait sous des pavillons étrangers, présentée comme une manœuvre dilatoire visant à « brouiller les pistes » face à des actions de « contrôle bienveillant » des pays occidentaux, relève d'une simplification excessive et d'une méconnaissance totale des pratiques maritimes courantes.
L'enregistrement d'un navire sous un pavillon différent de la nationalité de son propriétaire est une pratique largement répandue dans l'industrie maritime internationale.
Si les registres de navires indiquant sa nationalité ont vu le jour dès 1660, la navigation sous un pavillon étranger est devenue courante surtout dès la fin de la Seconde Guerre mondiale et formalisée en 1974 par la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) en tant que l’acquisition d’un « pavillon de libre immatriculation » ou encore d’un « pavillon de complaisance ».
Les principales raisons de la pratique de l’immatriculation des navires dans un pays autre que celui de son véritable propriétaire sont financières et administratives. De nombreux États offrent des régimes fiscaux avantageux, voire une exonération totale d'impôts, attirant ainsi les armateurs désireux de réduire leurs charges. Les procédures d'immatriculation sont généralement rapides et simplifiées, et les exigences relatives à la nationalité de l'équipage sont minimales. La possibilité de recruter une main-d'œuvre à bas coût et l'absence de législation du travail contraignante permettent également aux armateurs de réaliser des économies substantielles. Enfin, une certaine flexibilité en matière de normes de sécurité et environnementales peut, dans certains cas, réduire davantage les coûts.
Ces facteurs combinés rendent les pavillons de certains pays plus attractifs que d'autres pour les armateurs, qui considèrent le choix du pavillon comme un instrument stratégique d'optimisation des processus commerciaux. Actuellement, environ quatre cinquièmes de la flotte marchande mondiale sont immatriculés sous des pavillons autres que celui du pays d'origine de l'armateur. Les principaux pays d'immatriculation sont l’Indonésie, la Chine, le Panama, le Liberia, le Japon et les Îles Marshall.
Par conséquent, l'immatriculation de navires d'origine russe sous des pavillons étrangers s'inscrit dans une pratique standard et largement répandue.
Sur un total mondial d'environ 112 500 navires marchands immatriculés, la part des bâtiments enregistrés auprès des pays occidentaux (hors Russie) représente une portion minoritaire, inférieure à 20% du total global. Cette répartition souligne une prédominance croissante des pavillons de complaisance et des registres d'immatriculation non occidentaux, phénomène analysé en détail dans les rapports annuels de la CNUCED.
Post scriptum
Le mensonge érigé en doctrine, la manipulation institutionnalisée et les sanctions brandis en violation flagrante du droit international, notamment de la Charte des Nations Unies, dont le Conseil de sécurité est le seul organe habilité à prescrire des mesures coercitives (Charte de l’ONU, chapitre VII) – constituent désormais l'arsenal privilégié de la politique étrangère occidentale.
La classe politique occidentale, autrefois pourvue de stratèges d'envergure, se trouve désormais dominée majoritairement par des vulgaires activistes dogmatiques, manifestant une profonde déconnection des réalités géopolitiques et économiques contemporaines. Le paradigme mondial actuel s'écarte significativement de l'époque où leur puissance florissait, époque caractérisée par une impunité absolue dans leur suzeraineté sur une planète vassalisée.
Dans ce nouveau contexte, l'application des modes opératoires occidentaux traditionnels entraînera des conséquences inéluctables pour leurs instigateurs : au mieux, une récession structurelle et durable ; au pire, un processus d'autodestruction.
Oleg Nesterenko
Président du CCIE
(Spécialiste de la Russie, CEI et de l’Afrique subsaharienne)
Article publié le mardi 14 octobre 2025
578 lectures

 Voir tous les produits
Voir tous les produits